
HANDICHRIST
Pêle-mêle, tout et rien
|
| | | Si le Gouvernement passait.... |  |
| | |
| Auteur | Message |
|---|
Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  24.12.21 20:19 24.12.21 20:19 | |
| le P.S. serait en soins palliatifs ???
P.S. = Porte de Sortie à cause de la proposition 21 de François Hollande transformée en loi leonetti-claeys de fev 2016
NE votons PLUS, ne donnons plus rien à la recherche médicale et à l'Eglise... |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  12.01.22 19:13 12.01.22 19:13 | |
| |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  17.01.22 21:13 17.01.22 21:13 | |
| Eric Zemmour, Emmanuel Macron candidat, c'est du " hors parti ", on voit le résultat !
le mieux, c'est l'abstention... ... |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  17.01.22 21:15 17.01.22 21:15 | |
| De toute façon.. Brigitte Macron...  |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  19.01.22 10:53 19.01.22 10:53 | |
| [size=33]Présidentielle 2022 : Devant Bourdin, Pécresse fustige « la loi du silence » sur les violences faites aux femmes[/size]
EN CAMPAGNE Invitée de l’émission « La France dans les yeux », la candidate LR a déroulé son programme en promettant notamment un « choc de pouvoir d’achat »
20 Minutes avec AFP
Publié le 19/01/22 à 04h18 — Mis à jour le 19/01/22 à 04h18
ET RIEN SUR LA LOI DU SILENCE A PROPOS DE LA FIN DE VIE
STOPdonSTOPvoteSTOP |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  25.01.22 20:57 25.01.22 20:57 | |
| Anne ma soeur tu ne vois rien venir ? tu es foutue... à cause de François ! |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  17.03.22 20:03 17.03.22 20:03 | |
| Fin de vie : Macron propose une « convention citoyenne » pour trancher le débat sur l'euthanasie
Par Agnès Leclair
Publié il y a 45 minutes, mis à jour il y a 45 minutes
Écouter cet article
En avril 2021, l'Assemblée nationale a déjà débattu du sujet dans un contexte houleux.
En avril 2021, l'Assemblée nationale a déjà débattu du sujet dans un contexte houleux. Ludovic MARIN / AFP
Le président de la République a annoncé qu'il consulterait les Français s'il était réélu.
Une « convention citoyenne »pour trancher le débat sur la fin de vie. Jeudi, lors de la conférence de presse de présentation de son programme, le président de la République a annoncé qu'il opterait pour une consultation s'il était réélu.
À LIRE AUSSIFin de vie: avant de légiférer, faisons en sorte que les textes actuels soient appliqués
Emmanuel Macron a ouvert la voie à une possible évolution de la loi en indiquant que les conclusions de cette convention seraient soumises «à la représentation nationale ou au peuple». À eux de faire ou non le choix «d'aller au bout du chemin qui sera préconisé».
Une proposition déjà débattue
Sans détailler ses convictions, il a cependant salué la loi Claeys-Leonetti et jugé que la possibilité de laisser des directives anticipées sur sa fin de vie n'était pas assez connue. «Sur ce sujet, je souhaite que nous puissions avancer de manière apaisée», a-t-il fait valoir.
En avril 2021, l'Assemblée nationale a déjà débattu du sujet dans un contexte houleux. Une proposition de loi légalisant l'euthanasie, portée par le député Olivier Falorni (Libertés et Territoires), a été approuvée sur le principe par 240 élus. Mais son examen n'avait pas abouti alors que 3005 amendements avaient été déposés sur le texte et que le gouvernement s'était montré réticent à légiférer sur ce sujet sensible en pleine crise sanitaire.
Depuis, le thème de la fin de vie est attendu comme un des grands débats de société des présidentielles. Parmi les candidats, Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot (EELV) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) se sont engagés à modifier la loi actuelle qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté. En parallèle, les médecins de soins palliatifs estiment que la légalisation de l'euthanasie n'ouvrirait «pas seulement un droit à quelques-uns» mais «changerait irrémédiablement la manière dont toute notre société considère la mort.» Après la conférence d'Emmanuel Macron, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD) a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux : «Depuis 20 ans, les Français sont sollicités sur le sujet de la fin de vie. Comme eux, les députés sont majoritairement favorables à l'aide active à mourir. Une nouvelle convention citoyenne ? De la perte de temps. Mais nous y sommes prêts. Les Français sont prêts».
Un avis du CCNE (Comité national consultatif d'éthique) est également attendu sur ce thème. En 2018, dans le cadre des États Généraux de la bioéthique, l'instance avait conclu qu'il n'était pas nécessaire de modifier la loi existante qui permet une «sédation profonde et continue jusqu'au décès» pour les malades incurables dont le pronostic vital est engagé «à court terme». «Pour qui a participé aux états généraux de la bioéthique, cette convention citoyenne ne dit rien qui vaille, a commenté Tugdual Derville, délégué général de l'association pro-vie Alliance Vita. Ce fut un simulacre de participation. À l'arrivée, le président a tranché, sur des critères politiciens, plutôt qu'en faveur de la protection des plus fragiles».
À LIRE AUSSIErwan Le Morhedec, l’avocat qui rêve d’une autre fin de vie
En 2013, une conférence citoyenne, constituée d'un panel de 18 personnes et mise en place par le CCNE, s'était par ailleurs déjà prononcée en faveur du suicide assisté et d'une exception d'euthanasie.
le roi Macron veut "trancher le débat" ! drôle, non ?
NE votons PAS...
Admin qui refuse de voter depuis la dernière loi Léonetti de février 2016 et qui a dit adieu à l'Eglise... |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  21.03.22 11:31 21.03.22 11:31 | |
| Selon le président de l’ADMD, Jonathan Denis : « Aucun parti ne peut et ne doit négliger cette aspiration essentielle des Françaises et des Français à l’autodétermination en fin de vie. Les candidats à la prochaine élection présidentielle doivent s’emparer de ce sujet pour en faire LA question de société des débats à venir. A cet égard, l’ADMD a ouvert un site d’interpellation, ludique et interactif (www.lesfrancaissontprets.fr) pour que chacune et chacun puisse interpeller le ou les candidats de leur choix et leur rappeler l’importance de ce sujet de liberté qui concerne tout le monde, car nous allons tous mourir un jour. » |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 | |   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  27.03.22 20:28 27.03.22 20:28 | |
| "Macron assassin" ??? ??? ??? ??? ??? ???   Jean Léonetti ASSASSIN Jean Léonetti ASSASSINNE votez PAS NE donnez PAS N'adhérez PAS NE participez PAS Faîtes semblant d'être du néant et vivez pour vous |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  02.04.22 18:50 02.04.22 18:50 | |
| site Marianne
Amélie de Montchalin et l'euthanasie des personnes âgées, une fausse information tenace
Intox
Par Magazine Marianne
Publié le 30/03/2022 à 10:29
Dans un tweet, encore repartagé aujourd'hui, la ministre de la Fonction publique Amélie de Montchalin affirmerait qu'il faut « poser la question » de la « fin de vie anticipée » pour les personnes âgées « devenues un poids financier ». Problème, elle n'a jamais tenu ces propos.
Les fausses informations ont parfois la vie dure. Ce mardi 29 mars, un vieux tweet circulait sur les réseaux sociaux. Il montre une capture d'écran d'une émission où Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction publique, expliquerait : « Il y a un âge, lorsqu'on devient un poids financier très important pour la société, où la question de la fin de vie anticipée doit être posée ; il faut en finir avec les tabous. »
Initialement partagé par un compte anonyme, le message a ensuite été retweeté notamment par des personnalités telles que Bruno Gaccio, ancien auteur de l'émission satyrique « Les Guignols de l'info » sur Canal + et membre du parlement populaire de Jean-Luc Mélenchon.
ITINÉRAIRE D'UNE FAUSSE INFORMATION
La citation interpelle mais elle est fausse. La capture d'écran, qui se garde bien de montrer l'origine du tweet, est issue du compte parodique « Le Journal de l'Élysée » . La ministre n'a jamais tenu ces propos. « Le Journal de l'Élysée », qui affiche bien la mention « parodique » sur son compte, est coutumier des blagues de ce style. Celle sur Amélie de Montchalin a ainsi été publiée en septembre 2018.
À LIRE AUSSI : "Nous avons des choses à réformer" : pour Amélie de Montchalin, l'aide européenne n'ira pas sans contrepartie
Comme souvent avec ce type de détournement, il a connu plusieurs rebonds depuis sa création. Un premier a eu lieu en décembre 2019, au moment où la réforme des retraites était au cœur des débats politiques. La fausse citation ressurgit à nouveau en avril 2020. À cette période, la ministre avait même affirmé avoir reçu des menaces de mort pour ces propos fictifs. Aujourd'hui, le tweet revient pour attaquer le bilan d'Emmanuel Macron. Comme si le président avait besoin de citations tronquées pour être critiqué…
Il faut bien que Jacques Attali ait raison..
Oui, la réforme des retraites entraînera un tsunami
Admin
“Dès qu’il dépasse 60/65 ans, l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et il coûte cher à la société. Je crois que dans la logique même de la société industrielle, l’objectif ne va plus être d’allonger l’espérance de vie, mais de faire en sorte qu’à l’intérieur même d’une vie déterminée, l’homme vive le mieux possible mais de telle sorte que les dépenses de santé soient les plus réduites possible en termes de coût pour la collectivité. Il est bien préférable que la machine humaine s’arrête brutalement plutôt qu’elle se détériore progressivement. L’euthanasie sera un instrument essentiel de nos sociétés futures.”
Toujours en vie, Jacques ? Né le 1er novembre 1943 à Alger
Admin |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  05.04.22 12:53 05.04.22 12:53 | |
| MENTEURS !
Fin de vie : relancer le débat, changer la loi… Ce que proposent les candidats
Légaliser l’euthanasie, inscrire le droit à mourir dans la dignité dans la Constitution, relancer le débat, développer les soins palliatifs en France… Voici les propositions des douze candidats à la présidentielle sur le sujet de la fin de vie.
Une photo de l’unité de soins palliatifs de la clinique Sainte-Élisabeth de Marseille prise en 2018 lors d’un reportage. Photo d’illustration.
Une photo de l’unité de soins palliatifs de la clinique Sainte-Élisabeth de Marseille prise en 2018 lors d’un reportage. Photo d’illustration. | ARCHIVES /THOMAS BREGARDIS / OUEST FRANCE
Afficher le diaporama
Ouest-France Léa BOISTAULT.
Publié le 05/04/2022 à 11h00
Sujet de société sensible, la question de la fin de vie divise les candidats à la présidentielle, notamment la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté.
Actuellement, l’euthanasie et le suicide assisté sont interdits en France. Pour rappel, l’euthanasie et le suicide assisté consistent à l’utilisation de procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de personnes souffrantes et souhaitant mourir. La différence entre les deux termes réside dans la manière d’administrer le produit létal.
Pour le premier, il s’agit de demander à un médecin d’administrer au patient le produit en question. Dans le deuxième cas, c’est le médecin qui met à disposition un produit létal et le patient qui se l’administre.
En France, la fin de vie est réglementée par la loi Claeys-Leonetti, qui prévoit une sédation profonde et continue pouvant mener à la mort, mais sans euthanasie active.
Dans leurs programmes, certains candidats à la présidentielle proposent de relancer le débat sur la fin de vie, d’autres veulent modifier la loi pour aller plus loin ; d’autres au contraire ne souhaitent pas y toucher. En revanche, la plupart des candidats s’accordent sur la nécessité de développer davantage les soins palliatifs (ensemble des soins visant à améliorer le confort du malade, souvent en phase de fin de vie) en France. On fait le point.
Relancer le débat
La question de la fin de vie n’aura pas avancé durant le quinquennat d’Emmanuel Macron. Le sujet a pourtant fait l’objet de débats à l’Assemblée en avril 2021 lorsque le député Olivier Falorni, du groupe Libertés et territoires, a défendu une proposition de loi « donnant le droit à une fin de vie libre et choisie ». Celle-ci prévoyait la possibilité de recourir à une aide médicalisée à mourir « pour des personnes majeures, atteintes d’une maladie incurable en phase avancée ou terminale, et générant des souffrances inapaisables. »
Malgré un large soutien, la proposition de loi n’avait pas pu être examinée en totalité au printemps 2021, face à des milliers d’amendements déposés par quelques élus LR et un temps contraint.
S’il est réélu, Emmanuel Macron veut avancer sur le sujet de « de manière apaisée ». Pour cela, il propose de lancer « une convention citoyenne qui associera citoyens, spécialistes de l’éthique, professionnels ».
Fabien Roussel, souhaite lui aussi relancer le débat sur la fin de vie. Sollicité sur le sujet par nos confrères de L’Obs dans un article publié le 1er avril, le candidat communiste explique avoir évolué dans sa réflexion : « Si jusqu’à présent je ne souhaitais pas aller plus loin que cette loi, je pense aujourd’hui que nous sommes prêts à avoir un grand débat avec les Français pour permettre à chacun, si une majorité se dessine, de partir dignement, selon les modalités de son choix et sans être obligé d’aller dans un autre pays, à des coûts parfois très élevés. »
Avis partagé par le candidat Jean Lassalle qui souhaite un grand débat. « Il faut un grand débat ponctué par un référendum sur cette question », a-t-il répondu à un citoyen chez nos confrères de France Info .
Se diriger vers la légalisation de l’euthanasie
Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, sont favorables à la légalisation de l’euthanasie et proposent dans leurs programmes de modifier la loi afin de rendre cela possible. Si elle est élue, la candidate du Parti socialiste promet par exemple de mettre en place une nouvelle loi dès les premiers mois de son quinquennat.
Jean-Luc Mélenchon veut en plus inscrire le droit de mourir dans la dignité dans la Constitution. Pour le candidat de la France Insoumise, il s’agit là « d’une liberté fondamentale de la personne humaine ».
S’en tenir à la loi actuelle
À droite et à l’extrême droite, les candidats sont réticents à l’idée de rouvrir le débat sur l’euthanasie et le suicide assisté et préfèrent s’en tenir à la loi existante. Valérie Pécresse refuse une évolution de la législation en matière de fin de vie, estimant que la loi Claeys-Leonetti « est mal appliquée ». « Avant de lancer des débats, il faut faire appliquer la loi », avait-elle déclaré au micro de nos confrères de France Info en janvier.
Tout comme la candidate des Républicains, Eric Zemmour et Marine Le Pen refusent d’aller plus loin que la loi actuelle et sont contre la légalisation de l’euthanasie. « Je suis contre l’acharnement thérapeutique, mais il faut éviter l’euthanasie », avait déclaré le candidat d’extrême droite Eric Zemmour dans l’émission Élysée 2022 de France 2.
« L’euthanasie, c’est une barrière qu’il ne faut pas franchir » avait répondu Marine Le Pen à un citoyen dans une émission de nos confrères de BFMTV diffusée le 22 mars. La candidate du Rassemblement national a toutefois rappelé l’importance de développer les soins palliatifs, pour limiter la douleur des patients.
Mieux accompagner les personnes en fin de vie
La question du développement des soins palliatifs en France, voilà là un point sur lequel s’accordent la plupart des candidats. Valérie Pécresse souhaite « développer une culture palliative » sur tout le territoire, sans oublier « les quartiers populaires et les territoires ruraux ». Pour accompagner les personnes en fin de vie souhaitant mourir chez elles, la candidate veut notamment développer l’accompagnement de soins palliatifs à domicile.
Un point que l’on retrouve dans le programme d’Éric Zemmour, qui souhaite créer des unités de soins palliatifs sur l’ensemble du territoire. De son côté, Nicolas Dupont-Aignan qui ne veut pas non plus toucher à la loi, propose de doubler le nombre d’unités de soins palliatifs et mettre en place quelques lits de soins palliatifs dans les Ehpad.
Présidentielle 2022. Et vous, quelles sont vos idées pour la France ?
Yannick Jadot, lui, milite pour doubler le nombre de lits spécialisés en soins palliatifs ainsi que « les équipes mobiles de soins qui interviennent à domicile et à l’hôpital ». Le candidat écologiste entend aussi créer « des maisons de soins palliatifs réparties sur le territoire […] pour en faire des maisons de vie où sont accueillies les familles ».
HYPOCRITES ! |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  26.04.22 14:57 26.04.22 14:57 | |
| "IL A JOUÉ AVEC LE FEU": POUR JOSPIN, MACRON "A TOUT FAIT" POUR QUE LE PEN ARRIVE AU SECOND TOUR Hortense de Montalivet Le 26/04/2022 à 8:44 Et peut-être que Hollande a payé Léonetti pour que sa proposition 21 échoue... J'y avais songé !
Recevez virtuellement ma merde, ma pisse et mon vomi
Admin qui est dignement et noblement désolée
 |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  12.06.22 21:31 12.06.22 21:31 | |
| Abstention =
paix, tranquillité, mépris noble et digne etc etc
prix d'une bagnole électrique ?
écolo rime avec rigolo !
Léonetti ce n'est jamais fini ?
blablabla blablabla
NE votons PAS et NE donnons PAS
j'ai mal au bras et à la jambe
donc je ne suis pas morte! |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  20.06.22 0:52 20.06.22 0:52 | |
| un grand merci aux abstentionnistes pour les législatives françaises 2022 ! ! !
cependant une majorité relative, c'est tout de même un peu trop gentil ...
il aurait fallu pas de majorité du tout ! |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  08.07.22 16:12 08.07.22 16:12 | |
| je ne sais pas si mes concitoyens ont les mêmes pensées que moi à propos des 13 et 14 juillet à venir... |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  21.07.22 20:26 21.07.22 20:26 | |
| internet + covid = tuerie familiale dans l'Ain le Procureur aurait dit que " cela dépasse l'entendement " bof ou alors on devient indifférent ( sous le coup de la chaleur ? ) en plus il s'agit d'une famille recomposée... il faut vivre dans les grandes villes, on a la tranquillité...  |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  27.07.22 23:59 27.07.22 23:59 | |
| Message pour l'Assemblée Nationale
discutez, discutez... " cravate ou voile " ?
de quoi crever de rire et non de soif !
allez vous faire foutre !! |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  14.09.22 0:11 14.09.22 0:11 | |
| si le Gouvernement passe ici, je ne crois plus personne car j'ai vieilli donc j'ai mûri quelque part et internet fait douter de tout |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 | |   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  01.10.22 19:30 01.10.22 19:30 | |
| Dissolution Assemblée Nationale ? je m'en fous ! |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  02.10.22 13:45 02.10.22 13:45 | |
| Point commun entre François Hollande et Jean Léonetti, leur petite taille ( révélatrice du contenu de leur cervelle ? ) |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  08.10.22 17:44 08.10.22 17:44 | |
| Pas de problème puisque pas de solution
17 ans de loi Léonetti et ce n'est pas un record !JL me fait péter les plombs ( j'ai fait plusieurs sortes de jeûne par curiosité malsaine ), comment ces drogués finissent leur vie ? ils sont inaptes à la sédation profonde continue jusqu'au décès à cause de l'accoutumance aux produits sédatifs, d'après moiAdminCrise du crack à Paris : retour sur 30 ans d'errance et de consommation à ciel ouvert Alors que le camp insalubre d'usagers du crack fête sa première année d'installation dans le 19e arrondissement, retour sur l'histoire de cette drogue à Paris. La crise du crak dure à Paris depuis la fin des années 1980. La crise du crack dure à Paris depuis la fin des années 1980. (  IP3 PRESS/MAXPPP) Par Olivia Kouassi Publié le 23 Sep 22 à 6:28 Actu Paris Mon actu C’est un « problème sans fin ». Depuis 2019, les déplacements forcés de consommateurs de crack se multiplient à Paris jusqu’à l’évacuation, il y a pile un an, le 24 septembre 2021, des toxicomanes installés aux Jardins d’Éole, dans le 18e arrondissement. Des bus sont alors affrétés et une centaine de personnes est amenée aux portes de Pantin (Seine-Saint-Denis) à deux pas de la place Auguste-Baron dans le 19e arrondissement. À quelques jours de « l’anniversaire » de l’arrivée des toxicomanes, les opérations de police et les interpellations se multiplient aux abords du camp. Il faut dire que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a donné, en juillet 2022, une année au nouveau préfet de Paris, Laurent Nuñez, pour « régler » cette situation « dramatique ». À lire aussi Un an après l’installation du camp de crack, le maire de Pantin saisit la Défenseure des droits Une crise vieille de deux décennies Pourtant, le « problème » du crack, de sa consommation à ciel ouvert et de l’installation de ses usagers dans des campements insalubres, remonte à près de 25 ans, à la fin des années 1990. Quand, comment et pourquoi la consommation de cette drogue peu chère et dévastatrice a-t-elle pris racine dans la capitale ? Retour sur un feuilleton qui occupe la scène politique locale depuis deux décennies. Ces scènes se sont créées au gré des déplacements des populations d’usagers de crack, et des démantèlements de scènes opérés par les forces de police et par les stratégies de rénovation urbaine qui réduisent le nombre de petits espaces exploitables pour les usagers et qui favorisent la constitution des grandes scènes ouvertes. Inserm, Fédération Addiction, Aurore, Gaïa, Oppelia, Agora et collectifs de riverains Plan pour la disparition des scènes ouvertes de drogues Héroïne, première drogue consommée à ciel ouvert Jusque dans les années 1980, la vente en appartement entre usagers-revendeurs était la norme, détaille Alexandre Marchant, professeur agréé d’histoire et auteur de la thèse « L’impossible prohibition des drogues en France des années 60 à 90 ». L’héroïne arrive en France en 1983 et va rapidement proliférer dans la capitale dans un contexte de crise économique et de chômage de masse. Consommateurs et trafiquants de cette drogue extrêmement addictive vont rapidement se concentrer dans un petit quartier insalubre du côté de la gare de Lyon : l’îlot de Chalon. Près de 20 000 toxicomanes s’y approvisionnent alors. On note l’existence de ghettos tels que l’îlot de Chalon ou la rue de l’Ouest à Paris où il est possible de s’approvisionner aisément auprès de dealers qui agissent quotidiennement en toute impunité, inquiètent et exaspèrent une opinion publique d’autant plus angoissée que tout un chacun se sent concerné et en même temps impuissant. Juge d’instruction Bernard Leroy dans ses notes à la Chancellerie L’émergence des scènes ouvertes de la drogue à Paris dans les années 80-90, Alexandre Marchant Le quartier sera entièrement détruit en 1985 et son évacuation sèche « ne fera que déplacer le problème », notamment dans le quartier de la Goutte d’Or dans le 18e arrondissement de la capitale. L’arrivée du crack dans la capitale Mais la « grande décennie » de l’héroïne et ses premiers phénomènes de scènes ouvertes, ces lieux de consommation à ciel ouvert, seront le terreau idéal à la prolifération du crack qui fait son entrée dans la capitale en 1989. Le « caillou », dérivé peu cher de la cocaïne, arrive alors des Antilles et trouve, selon Alexandre Marchant, « dans les stations de la ligne 9 du métro ses premiers lieux de deal «publics» ». Vidéos : en ce moment sur Actu Strasbourg-Saint-Denis, Bonne-Nouvelle… Le trafic prend rapidement racine et les consommateurs vont rapidement se concentrer autour de la place Stalingrad et de la rotonde Leroux. Le lieu, assez espacé et situé dans un quartier populaire, va, selon l’historien, expliquer ce point de fixation historique des consommateurs de crack. Les riverains sont rapidement indignés et apeurés par ce nouvel espace de consommation à ciel ouvert et organisent en 1994 une grande manifestation. Comme autour de l’îlot Chalon, la forte présence policière n’empêchera pas la situation de se dégrader et l’insécurité s’accroit dans le quartier. À court de solutions et face à la mobilisation des riverains, la mairie de Paris décide en 1994 d’installer des forains. Ce sont eux qui vont désormais empêcher les toxicomanes d’y stationner pour y faire tourner manèges, cirque et baraques - employant à l’occasion des méthodes musclées pour prendre véritablement possession du lieu... Olivier Doubre La "scène" du crack, lieu de vente, de consommation et d'affrontement - Vacarme Un retour aux sources Après quelques années d’éparpillement dans les lieux de consommation historiques (la Goutte d’Or, le 9e arrondissement, etc.), où « CRS et baceux parcourent les rues et forcent les usagers à se déplacer sans trêve, sans régler le problème », les consommateurs de crack font un retour massif place Stalingrad en 2001. Une nouvelle mobilisation de riverains très médiatisée et la création du collectif anti-crack (CAC) va permettre une intervention musclée de la police. La colline du crack Les multiples actions coups de poing place Stalingrad vont permettre la création d’un nouvel espace de scène ouverte un peu plus au nord de Paris, à la frontière de Saint-Denis. Les énormes travaux de réaménagement du quartier de la plaine Saint-Denis favoriseront l’installation de centaines de consommateurs au niveau de Porte de la Chapelle, sur les terres-plains de l’immense échangeur entre l’autoroute A1 et le boulevard périphérique. Le terrain vague se transforme rapidement en campement pour des usagers précaires et devient « la colline du crack ». Véritable lieu de vie, de deal et de consommation, le camp va prendre racine malgré la quinzaine d’évacuations organisées par la police entre 2005 et 2019. Les usagers seront définitivement déplacés en 2019 sous le règne du préfet de police de Paris Didier Lallement lors du démantèlement définitif du camp. Ce dernier se déplace alors en partie porte d’Aubervilliers avant d’être, lui aussi, démantelé en janvier 2020. Deux années d’intenses déplacements forcés Dans un ultime retour aux sources, Stalingrad devient à nouveau, dès l’évacuation de la colline, le centre névralgique du deal avant que les consommateurs de crack ne soient, une fois, encore déplacés par les forces de l’ordre, cette fois dans le jardin d’Éole dans le 18e arrondissement en mai 2021. La forte mobilisation des riverains, et notamment des tirs de mortiers lancés sur les consommateurs, entraînera, le 1er juillet 2021, leur interdiction d’accès au parc. Sans solution, ces derniers se retrouvent alors aux abords du parc, plus précisément rue Riquet dans le 19e arrondissement. Ce feuilleton historique nous amène ainsi, il y a pile un an, le 24 septembre 2021, lors de l’évacuation d’une centaine de personnes vers la place Auguste Baron dans le 19e arrondissement de la capitale. L’érection d’un mur entre Paris et Pantin, les multiples mobilisations et manifestations, et enfin l’annonce le 21 septembre 2022 par le maire de Pantin du saisissement de la Défenseure des droits : le camp Auguste Baron, qualifiée de « plus grande scène de consommation de crack à ciel ouvert d’Europe » est devenu le symbole de l’échec d’une politique de répression. La répression policière remise en question ? Au début des années 2000 déjà, le conseiller du 19e arrondissement Roger Madec déclarait être « conscient du fait que la seule répression policière ne peut résoudre sur le long terme un tel problème ». La présence constante depuis deux décennies de forces de l’ordre aux abords des scènes ouvertes en est notamment la preuve. La figure du drogué irrécupérable a pu passer tranquillement de l’héroïnomane au «cracker» sans que les Français ne soient informés des raisons qui ont fait disparaître l’héroïne de nos rues en une décennie. Fabrice Olivet, membre de la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). Janvier 2022 - revue Swaps Trois années après l’adoption du plan crack, associations et collectifs de riverains en partenariat avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ont dévoilé jeudi 22 septembre 2022 un rapport « pour la disparition des scènes ouvertes de drogues ». « La disparition des scènes ouvertes et l’amélioration de la vie des usagers de crack, des riverains et des conditions de travail des professionnels nécessite des actions volontaristes de la part des pouvoirs publics », rappelle notamment le rapport. Médiation, lieux d’accueil adaptés, insertion socioprofessionnelle… Pour ces différents acteurs, la crise du crack peut se régler grâce à l’accompagnement. Car, comme le résume Alexandre Marchant, « chasser ne fait que déplacer le problème ». |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  18.10.22 17:00 18.10.22 17:00 | |
| Lola
Léonetti
... ... ...
?????
!!!!!
le crack à Paris
et Marseille ?
rien de nouveau sous le soleil
on meurt alors qu'on ne l'a pas demandé
on ne meurt pas parce qu'on est obligé de vivre
si les toubibs n'avaient pas soigné Poutine, les Ukrainiennes ne seraient pas violées
etc etc |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: ?????????????? Sujet: ??????????????  04.11.22 12:55 04.11.22 12:55 | |
| SALAH ABDESLAM S'EST MARIÉ RELIGIEUSEMENT DEPUIS SA CELLULE
Vincent Vantighem avec Hugo Septier
Le 03/11/2022 à 19:59
Partager
Twitter
Salah Abdeslam
Salah Abdeslam - DSK / POLICE NATIONALE / AFP
Le terroriste de 33 ans est désormais l'époux d'une femme présentée par son père et qu'il ne connaissait pas au préalable.
Une union sous haute surveillance. Comme l'a appris ce jeudi BFMTV, confirmant une information de RTL, Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos du 13-Novembre, s'est marié religieusement en détention cet été.
Aujourd'hui âgé de 33 ans et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour son rôle dans les attentats du Bataclan et des terrasses parisiennes, Salah Abdeslam a pu se marier, par téléphone, avec une jeune femme qui lui a été présentée par le truchement de son père et qu'il ne connaissait pas au préalable.
Play Video
Il s'agit d'un mariage religieux et non pas d'une union civile, qui aurait nécessité un passage en mairie. Comme le souligne de son côté RTL, sa compagne est identifiée par les services de renseignement français. |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  04.11.22 14:48 04.11.22 14:48 | |
| les femmes des djihadistes ont été rapatriées de Syrie avec leurs mômes, certaines ont été mises en examen... ... ...
on n'oublie pas même avec des trous de mémoire
pan pan pan
décès ou survie ?
et S.A. se marie "religieusement" en prison !
quel monde de fous en liberté |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  18.01.23 13:28 18.01.23 13:28 | |
| DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : Olivier Véran espère que "cette expression populaire ne se transformera pas en blocage"
Une forte mobilisation est attendue jeudi pour protester contre le projet du gouvernement de repousser l'âge légal de départ à 64 ans.
et moi j'espère que ce jeudi sera comme le samedi en France...
il y a eu le samedi ( avec Alain Cocq ... )
il y aura le jeudi ( tous les jeudi ? )
j'attends la suppression de la dernière loi Léonetti de fev 2016 car elle est plus qu'inutile ...
|
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  03.05.23 23:33 03.05.23 23:33 | |
| Vous êtes tous et toutes dans la merde je ne peux que m'en réjouir ! avec noblesse et dignité ? ( pour imiter F.H. ) la rancune fait vivre, çà c'est évident !  |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  06.06.23 0:37 06.06.23 0:37 | |
| Bonne ou mauvaise manif en France demain mardi 6 juin 2023 ? la dernière avant l'été, pas la dernière de cette année ! Le G.J. handicapé A.C. est trop loin, on l'oublie l'autre individu A. C. aurait dû casser la gueule à J.L. avant févrer 2016 Qu'elle est digne et noble, cette France ! L'hypocrisie contnue de régner ... 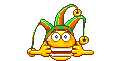  |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  30.06.23 13:46 30.06.23 13:46 | |
| Vous êtes dans la merde,
et moi je m'en réjouis
désolée
dignement et noblement désolée
je fais juste joujou avec le web pour me venger
me venger de ce que je subis depuis tant d'années
je pourrais écrire des noms, des prénoms, des pseudos, des initiales |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  05.01.24 21:10 05.01.24 21:10 | |
| |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  12.01.24 19:26 12.01.24 19:26 | |
| un Premier Ministre homo ?
Catherine Vautrin ( la Manif pour Tous ), ministre de la Santé ?
je ne comprends pas... sans arrêter de dégueuler, pisser et chier sur vous tous et toutes sans exception...depuis fevrier 2016
Ministre du Travail, de la Santé etc comme le connard Xavier Bertrand
J'AI LA HAINE...
Bande d'hypocrites et de salauds |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  22.01.24 21:12 22.01.24 21:12 | |
| Tous les gouvernements sont des paniers de crabes
il n'y a rien à attendre des uns et des autres |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  29.01.24 3:48 29.01.24 3:48 | |
| Nos agriculteurs anticipent la salade de Léonetti
Nous allons mourir de faim bien vivants !!!
3h40 et je ne dors tjrs pas
ils ont supprimé deux molécules chéries !
Myolastan et Décontractyl, je dormais avec...
l'insomnie peut tuer ... |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  09.02.24 19:15 09.02.24 19:15 | |
| Robert Badinter est mort
Tant mieux !
il était contre la peine de mort et l'euthanasie
quand la peine de survie va disparaitre de la France ? |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  18.06.24 1:23 18.06.24 1:23 | |
| Emmanuel et son entourage aurait tout calculé froidement? Ma TV est éteinte, c'est comme si l'Elysée, Matignon, le Sénat, l'Assemblée Nationale n'existaient plus ! Mes yeux sont secs, mon sourire et mon rire ont disparus. Je suis quelqu'un d'autre qui ne croit plus en rien. Et pourtant s'il m'arrive de discuter avec des inconnus sur des sujets graves, j'arrive à faire sourire ou rire ! Je ne me suis jamais comprise vraiment alors mon je fait son jeu comme il peut !   |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  19.06.24 17:46 19.06.24 17:46 | |
| je NE vote PLUS depuis la dernière loi Léonetti Clayes fev.2016
à cause de la proposition 21 qui a disparu
il vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire une faute ou une erreur...
Enchantée que la France, l'Europe, le monde soient ds la merde ! |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  14.07.24 18:48 14.07.24 18:48 | |
| |
|   | | Admin

 Messages : 24230 Messages : 24230
 |  Sujet: Re: Si le Gouvernement passait.... Sujet: Re: Si le Gouvernement passait....  14.07.24 18:52 14.07.24 18:52 | |
| |
|   | | | | Si le Gouvernement passait.... |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|
